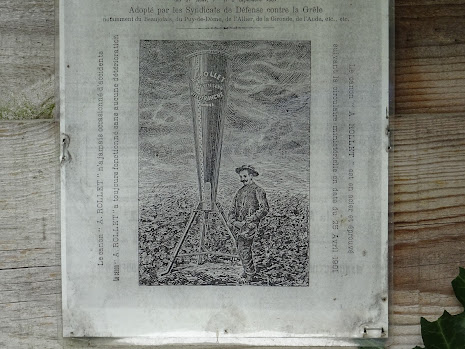L’incarnation de ce que devait être le journalisme, un métier joyeux et généreux
La rédaction a appris lundi la mort de la cofondatrice et pilier de «Libération». Ses anciens collègues rendent hommage à son humour, sa curiosité, sa rigueur et son sens de l’amitié.
Deux blondes dans un journal macho
Annette Lévy-Willard, ancienne journaliste à Libération
«Le vrai homme est rare !» Nous avions collé le poster géant d’un mâle sublime (et velu) sur le mur du minuscule bureau que nous partagions, Béatrice Vallaeys et moi, rue de Lorraine (XIXe arrondissement de Paris) aux temps héroïques de Libération. Soit avant la victoire de Mitterrand en 1981, le déménagement du journal rue Christiani (XVIIIe arrondissement) et ensuite la très chic rue Béranger (IIIe arrondissement), dans une lente ascension vers la respectabilité. Cette pub virile pour une eau de toilette masculine avait titré sobrement «L’homme est rare», à quoi Béatrice avait rajouté au feutre «le vrai homme». Les mecs qui pénétraient dans notre antre encombré de vieux journaux semblaient hésiter.
Il y avait deux «blondes» en mini-jupes ou jeans serrés qui terrorisaient l’homo liberatus : nous ne le détestions pas, mais nous voulions nous faire entendre en cette fin des années 70, où le mot «féministe» était encore une insulte. Béatrice, l’une des deux «blondes» du journal, nous a quittés il y a quelques jours. J’étais arrivée dans la jungle sympathique de la rue de Lorraine quand elle avait déjà le statut respectable de cofondatrice de ce journal en 1973. C’était une petite communauté fusionnelle d’une génération qui avait enfin obtenu la pilule et l’avortement ; l’homosexualité était sortie du placard et on trouvait normale une circulation sexuelle intense, jusque dans les douches détournées de leur fonction d’hygiène publique. C’était avant le sida qui allait décimer cette génération à partir de 1985.
Béatrice m’impressionnait, elle était la seule à affronter cette rédaction post-gauchiste, sans syndicat, sans règles… encore basée sur le patriarcat. Engueulades, articles jetés à la poubelle et machines à écrire balancées à la figure, ce journal brillant et innovateur sortait tous les jours dans un accouchement violent et inespéré : «C’est un miracle quotidien», disait-elle.
On avait mis au point plusieurs axiomes pour survivre dans la jungle. Béatrice : «Il faut tout de suite montrer qui est Raoul !» Très efficace. Il faut appliquer la règle des Tontons Flingueurs en frappant la première, en occupant le terrain, en prenant le pouvoir (si c’est possible). Moi : «Il ne faut pas poser de problèmes, il faut proposer des solutions», librement adapté d’une citation de Karl Marx. Plus souple. Béatrice : «Avant tout, il faut grandir l’Homme» et on se tordait de rire. Mais la tactique marche toujours. Je le vérifie encore.
Très grande et très belle, Béatrice avait une voix rauque qui portait loin. Moi pas. Mais j’avais une grosse moto. Et on croyait au journalisme, on se battait pour l’information, contre les idéologies et les anathèmes. On prenait la parole quand ce n’était pas à la mode. On s’est battues contre le soutien du journal aux pédophiles au nom d’un soi-disant «droit à la sexualité des enfants». On n’a pas gagné et on a été traitées d’hétéro-flics. Béatrice a défendu les mouvements des prostituées et même leurs clients. On a un peu gagné. Elle a demandé à nos camarades masculins de couvrir les procès des violeurs parce que nous, les filles, cela nous rendait malades. Là on a gagné, ils ont fait d’excellents papiers.
Béatrice fonçait dans un journalisme tout-terrain, bousculant les obstacles sur sa route, elle marchait vite. Les choses allaient changer, un pas après l’autre. On continuait de beaucoup rire – la colère fait des rides, disait-elle. Plus d’une quarantaine d’années à s’amuser et à être fières d’avoir fait bouger les lignes et la société. Elle aurait été ravie d’écouter Clément Ghys, très jeune journaliste à Libération en 2008, décrire «ce duo de blondes en mini-jupes qui rigolaient toujours et que les gens appelaient secrètement “les deux Ab-Fab”». En référence à la série déjantée Absolutely Fabulous. Aujourd’hui rédacteur en chef adjoint au Magazine du Monde, Clément se souvient encore des conseils qu’elle lui avait donnés : «Il ne faut jamais lâcher contre les cons, les machos, les homophobes…»
Béatrice, tu avais raison. On ne t’oublie pas. On ne t’oubliera pas.
«Quand elle était contente, tout l’étage était au courant»
Maïté Darnault, correspondante à Lyon
Ma première pige dans Libération, sur le crépuscule des squats de Berlin, je l’ai écrite en 2010 pour Béatrice Vallaeys, qui l’a acceptée avec enthousiasme. Quand Béatrice était contente, tout l’étage était au courant. 18 000 signes, c’est long, ça fait quatre pages du journal, il y a moyen de se perdre quand on a la plume pas encore rodée. Elle m’avait vue passer dans les couloirs en tant que secrétaire de rédaction, par intermittence au gré de mes CDD, se souvenait surtout de mon piercing dans le nez. Quand je lui ai rendu le papier, elle a eu cette phrase tellement décalée : «Parfait, tu sais écrire !» Comme si elle n’en avait pas douté avant de me donner ma chance. Une chance à 18 000 signes, un peu barrée la patronne, quand même.
J’ai écrit pour elle durant deux ans, depuis l’Islande, l’Irlande ou la Libye tout juste libérée de Kadhafi. Un impératif, le débrief dans son bureau : «Vas-y, raconte.» Et après coup : «C’est ça que je veux lire.» Prévoir la demi-journée pour un rendez-vous, le plus difficile étant d’atteindre son bureau. «J’arrive, ma chérie.» J’ai passé quelques heures, rue Béranger, à papoter avec Richard Poirot et Philippe Brochen, dont les bureaux se trouvaient devant celui de LA Vallaeys, vitré – non pas tant parce qu’elle était cheffe mais parce qu’elle était du genre sonore –, attendant qu’elle ait fini son dixième coup de fil, son énième blague. Eviter de trop se prendre au sérieux, voilà ce que je retiens de Béatrice, tout comme sa gentillesse, sa générosité, son rire, cette joie et la tendresse qu’elle vouait à son fils. C’est à lui que je pense aujourd’hui, ainsi qu’au compagnon de Béatrice et à ses proches, dans ce moment d’immense chagrin.
La dame blonde du Congo
Maria Malagardis, journaliste au service Monde
Béatrice était, aussi, une blonde africaine. Une Belge, née au Congo, ce vaste pays grand comme quatre fois la France, qu’elle quittera, encore enfant durant la période trouble de l’indépendance. Ce n’était alors qu’une petite fille, cachée avec ses sœurs et son frère à l’arrière d’un pick-up qui va traverser cet immense pays jusqu’à l’aéroport de Léopoldville, la capitale, rebaptisée depuis Kinshasa.
De ce départ tragique et périlleux, tu gardais dans ton salon, Béatrice, cette photo dont tu aimais rappeler les circonstances. Elle avait été publiée dans le Soir, le grand quotidien belge. Un cliché en noir et blanc pris sur le tarmac de l’aéroport de Bruxelles. On y voyait quatre enfants blonds qui venaient de descendre de l’avion. Ils se tenaient par la main, tournant ostensiblement la tête pour échapper aux caméras. C’est ta mère qui vous avait ordonné de ne pas regarder les paparazzi au moment où s’achevait cette fuite du Congo.
Depuis, Béatrice avait une drôle de relation avec son pays natal. Sa sœur, Anne, y était retournée, publiant même un livre à succès : Indépendance Cha Cha, en référence à la célèbre chanson sur un rythme de rumba qui fera danser tout le Congo, et même une grande partie de l’Afrique, à l’ère des indépendances. Béatrice, elle, n’a jamais voulu revoir le Congo. Tout en étant toujours fascinée et aimantée par son destin et celui de l’Afrique. On en parlait souvent ensemble.
L’ironie du destin justement, a voulu qu’on apprenne ton décès, brutal et si injuste, lundi. Le jour même où, à Bruxelles, la famille de Patrice Lumumba se voyait remettre enfin la seule relique qui reste du leader indépendantiste assassiné en 1961, un an après ta fuite éperdue de ce pays. Et que reste-t-il de Lumumba ? Juste une dent ! Seul vestige de son corps dissout dans l’acide. Je sais combien tu aurais abondamment commenté, avec des exclamations, peut-être même des rires, ce moment surréaliste de la cérémonie de remise d’une dent à la famille, dans le château du roi des Belges. On n’aura jamais cette conversation-là.
On en a eu tant d’autres. Et notamment une, à trois. Béatrice était alors à la tête du magazine du week-end de Libé, dont elle assurait la publication avec un enthousiasme débordant. Nous devions faire ensemble, à Bruxelles, l’interview d’un jeune auteur flamand, David Van Reybrouck, qui venait de publier une somme de plus de 700 pages sur l’histoire du Congo. J’avais préparé l’interview, en bonne élève scrupuleuse, saturant mon exemplaire de pages cornées, soulignées, annotées. Je ne suis pas certaine, Béatrice, que tu en avais fait autant. Même si tu étais une grande lectrice, toujours prête à conseiller ou offrir un livre. Bref, toi, tu t’es pointée les mains dans les poches, nonchalante et élégante. Très vite, tu t’es mise raconter ton Congo à toi, tes souvenirs lointains, tes interrogations sur la dérive tragique de ce pays, qui a si rarement connu la paix depuis l’indépendance, si riche et toujours pillé. Et bientôt, vous m’avez totalement oubliée, tous les deux, négligeant mes questions préparées à l’avance, pour entamer une conversation à bâtons rompus que l’interviewé semblait trouver passionnante, visiblement séduit par ta spontanéité, et même parfois ta naïveté.
Un dernier souvenir : celui d’un déjeuner chez toi. Nous avions parlé de mon fils, né en Afrique du Sud, et des identités multiples que chacun de nous abrite. Tu connaissais bien le sujet. Toi, devenue si Parisienne, plus tout à fait Belge, et encore moins Congolaise. Et en même temps façonnée par ces passés multiples que tu revendiquais. A un moment, tu t’es interrompue, fixant soudain l’un des tableaux posés à même le sol dans ton appartement. C’était une vieille carte, représentant les différentes tribus de l’Afrique australe, dans un cadre en bois splendide. «Ce tableau, c’est pour ton fils ! On le ramène chez toi !» Mais il était si lourd ! C’était absurde. Ce n’est pas ce qui pouvait t’arrêter. Et nous voilà, à le descendre péniblement par les escaliers, avant de le caler vaille que vaille dans ta petite voiture. On a tellement ri de notre maladresse à transporter ce truc impossible. Ce rire tonitruant en cascades, il va nous manquer. Salut, dame blonde du Congo, on ne t’oubliera jamais.

Béatrice Vallaeys, lors du numéro spécial : «Libé tout en Gaultier», où Jean-Paul Gaultier, couturier français, a créé une ligne inédite de vêtements en papier journal et fait défiler le personnel de Libération, les 25, 26 et 27 mai 2011. (Patrick Swirc/Patrick SWIRC)
«Elle donnait envie d’avoir des idées, de lui en proposer»
Anne Diatkine, journaliste au service Culture
Béatrice n’arrêtait pas de parler mais elle était capable d’écouter, de surveiller un enfant du coin de l’œil, de montrer des photos, de tendre un livre, de répondre au téléphone, d’improviser un cadeau – elle était généreuse – tout en poursuivant ses cavalcades de mots, de parenthèses, les digressions n’en finissaient pas, sa voix et son rire emplissaient tous les espaces, c’était l’ensemble du passé – souvent à Libération – qui remontait dans ce déluge, et trois heures plus tard, on était toujours surprise de s’apercevoir que oui, elle avait parfaitement en tête ce qu’on avait tenté de lui souffler, ce pour quoi on avait eu l’imprudence d’entrer dans son bureau délimité par un mur en verre, et qu’on avait supposé à tort qu’elle avait oublié. Béatrice avait une qualité rare et évidente, la seule qui vaille lorsqu’on occupe un poste de direction, et pourtant aucune école de journalisme ou de management ne l’enseigne : elle donnait envie d’avoir des idées, de lui en proposer, et ces idées n’étaient pas bizarres, elles prenaient même l’allure de l’évidence mais ce n’est qu’à son contact qu’elles surgissaient. Rencontrer les figurants dans un Ehpad psychiatrique au côté de Juliette Binoche, dans Camille Claudel de Bruno Dumont, plutôt que la comédienne star ? Evident. Faire un entretien avec la plus ancienne des scriptes Sylvette Baudrot ? Evident. Interviewer une sociologue spécialisée dans les traces que laissent les chewing-gums sur le bitume quand on les écrase ? Evident.
Béatrice communiquait son enthousiasme, bien sûr, ce qui est déjà formidable, mais son secret était autre : elle faisait confiance. Nul besoin de se battre, d’être un as de la rhétorique, de se métamorphoser en publicitaire de soi-même ou de rédiger d’assommant synopsis. Nul besoin de jouer un rôle, la relation qui se nouait n’était pas formatée par le pouvoir, elle pouvait donner à un stagiaire la chance d’écrire l’enquête dont il rêvait et fermer la porte à un journaliste plus aguerri. Béatrice écrivait aussi, et sa plume était ferme. C’était avant #MeToo, avant l’affaire Weinstein : la tribune qu’elle a écrite au lendemain de l’épisode DSK au Sofitel est à relire d’urgence, elle frappe par sa clairvoyance. Béatrice fait partie d’une génération qui a fondu sa vie dans Libération. Ne pas croire cependant que la confusion était totale et qu’elle n’était pas apte à prendre ses distances, à avoir une vie hors du journal. Elle avait notamment quitté Libération pendant deux ans à la naissance de son fils, Félix, sa grande fierté, l’amour de sa vie.
Après être partie définitivement du journal, contrairement à beaucoup, elle continuait de le lire – sur papier le matin, disait-elle, sur le Web, le soir. Elle repérait les nouvelles plumes, les louait, se disait sans nostalgie. La dernière fois qu’on s’est vues, c’était chez moi. Elle nous avait lancé cette phrase, bravache: «J’ai l’air d’aller bien, mais je vous informe que ça ne va pas du tout.» Béatrice n’aimait pas inquiéter. Elle parlait, parlait, un mur protecteur de paroles, finalement, bien plus qu’un flot, mais elle était pudique. On a senti qu’il ne fallait pas insister.
Béatrice, notre amie
Bernadette Sauvaget, journaliste au service Société
Depuis lundi, je sais que l’on ne devient pas seulement orphelin de ses parents. Mais aussi de ses amis. Depuis lundi, je suis, comme beaucoup d’autres, orpheline de Béatrice. Il y a douze ans, elle m’avait rouvert les portes de Libération parce qu’un reportage que je lui proposais l’avait enthousiasmée. Elle était une cheffe exigeante et créative, renouvelant sans cesse ses curiosités, tentant à chaque instant de comprendre le monde. On discutait beaucoup ; on s’engueulait aussi. La marche de l’humanité, ces derniers temps, l’inquiétait. Car la lumineuse Béatrice était hantée aussi par des noirceurs, la peur surtout du retour possible du cancer qu’elle avait si douloureusement combattu.
Béatrice, généreuse comme peu de gens, savait tricoter les liens d’amitié. Ensemble, nous avons ri, beaucoup, énormément. Vécu des choses imprévues, poétiques. Comme de passer trente-six heures enfermées dans le couvent de mère Marie-Chantal, assistant en silence au repas (ce qui n’était pas rien pour elle!) et aux offices qu’elle enregistrait en douce. Un peu lasses de cette vie-là, nous avions cueilli et mangé des cerises dans le jardin du couvent.
Depuis longtemps, les étés de Béatrice, fantasque et rebelle, c’était la Corse, son autre maison, son autre famille. Ses liens anciens avec cette île qui lui ressemblait étaient complexes et passionnés. Là-bas, elle m’a fait conduire, souvenir inoubliable, sa vieille Peugeot décapotable. Béatrice avait plusieurs pays. Mais celui qui comptait le plus, c’était celui des livres. Elle en dévorait des tonnes, en conseillait, en offrait. Dans les douleurs et les vacheries de la vie, ils étaient son refuge, son havre ultime.
«Une époque révolue, faite de papier, de sténos, de cabines téléphoniques, de clopes grillées dans la rédaction»
Marceau Taburet, journaliste au service Actu
Elle avait une façon unique de clore ses histoires par un enivrant «Qu’est-ce qu’on a ri». Ce matin-là, il est tôt et elle rit déjà. Beaucoup. De tout. Nous nous retrouvons sur le quai de la gare de Brive-la-Gaillarde. Quand un agent SNCF, à qui elle demande si elle peut monter à bord, lui répond sèchement et lui claque la porte au nez, elle préfère en rire. La mauvaise humeur environnante n’avait aucun effet sur elle.
Assise côté fenêtre, elle disserte sur la gauche, le pouvoir, la guerre, l’argent, l’amour, la mort. Béatrice avait cette capacité à passer d’un sujet à un autre comme un enfant joue à saute-mouton. Au gré de paysages qui défilent sous nos yeux, Macron, Valls, Mélenchon et Mitterrand en prennent pour leur grade.
Libé, c’était sa maison. Elle aimait le journal éperdument. Elle connaissait tout et tout le monde. Elle avait un secret : tout l’intéressait. Du Congo, ce pays natal qu’elle avait dû quitter dans la douleur en pleine période indépendantiste, elle pouvait en parler des heures. La guerre en Ukraine la préoccupait. Et si Poutine, dans sa folle entreprise, décidait d’envoyer ses troupes jusqu’en Pologne, où vit son fils ? La Corse la passionnait. L’Europe aussi. Les arts étaient, pour elle, un antidote aux malheurs du monde. Pour déjouer la défiance démocratique et le rejet des institutions, il fallait lire Contre les élections de David Van Reybrouck. Pour comprendre la résurgence du mal, il fallait retourner «à Lemberg» avec Philippe Sands. Elle avait un mot pour Finkielkraut, Lanzmann, Beauvoir ou Sartre. Elle connaissait bien Robert Badinter. Une phrase l’avait marquée chez lui : «Je gagne à être connu.» Elle aimait le répéter. «C’est étonnant comme phrase», disait-elle en riant.
Béatrice gardait quelques restes des envolées libertaires des années 70, regardait avec méfiance la gauche d’aujourd’hui mais ne jugeait jamais l’époque. Elle avait une anecdote à raconter sur chaque personnalité politique, artistique ou littéraire qui compte. On s’est même posé une question : comment tant de souvenirs peuvent rester gravés dans une seule personne ? C’en était impressionnant. Quand un ancien du journal mourait, c’est elle qu’on appelait pour écrire sa nécro. Ça la faisait marrer.
Le jeune journaliste que je suis l’écoutait avec émerveillement. Une époque révolue, faite de papier, de sténos, de cabines téléphoniques, de clopes grillées dans la rédaction ou de prises de bec en réunion défilait alors sous mes yeux. Une époque de rêves, d’idéaux, de flamboyance et d’errements aussi. Où l’arrivée des Khmers rouges au Cambodge était vue comme «enthousiasmante». Ce qui l’agaçait profondément.
A la nuit tombée, Béatrice se précipitait sur l’édition numérique de Libé pour y lire certaines plumes qu’elle trouvait «formidables». Rien ne l’ennuyait plus en revanche qu’un article sur les trottinettes électriques ou les coiffures à la mode. Bien qu’à la retraite, elle fourmillait de projets. D’abord, les livres, dont un qu’elle aurait aimé faire sous forme de dialogues avec le député insoumis Adrien Quatennens. Ensuite, les films, dont celui sur l’ancien président François Hollande qu’elle suivait partout depuis sa sortie de l’Elysée. L’un et l’autre s’estimaient. Béatrice ne s’arrêtait jamais mais voulait laisser la place aux jeunes. Elle aimait dire «la nouvelle génération». Tel un passage de flambeau, elle m’avait conseillé de m’amuser sans trop me prendre au sérieux. Et c’est vrai, ce jour-là, «qu’est-ce qu’on a ri».
«¬J’ai eu de la chance d’être façonné par la plus belle personne qui soit»
Jean Quatremer, correspondant européen
C’était le 9 juin, dans un restaurant italien du quartier de l’Odéon. Une soirée, forcément arrosée, passée à parler de la guerre en Ukraine, de Libération, de l’Europe, de Libération, des élections, de Libération, de nos vies, de nos enfants, et encore de Libération. Libération toujours et encore, car le journal coulait littéralement dans les veines de Béatrice, elle qui était là au tout début de l’aventure, à 18 ans à peine, avant même Serge July. Elle y a consacré sa vie et son énergie au point d’y sacrifier une partie de sa santé, mais sans aucun regret, jamais. En la quittant ce soir-là, sans savoir que c’était la dernière fois, je restais fasciné par sa passion, son enthousiasme, sa verve, sa curiosité, sa générosité, intacts en dépit des années. ¬Impossible de trouver chez Béatrice de la rancœur, de la lassitude, de la morgue, du cynisme : tout était sujet d’émerveillement chez elle, presque un émerveillement d’enfant. ¬Béatrice était pour moi l’incarnation de ce que devait être le journalisme, un métier joyeux et généreux.
Ne cherchez pas ici un article froid et détaché, car sans Béatrice je ne serais pas celui que je suis devenu et sa disparition me ravage. J’ai eu de la chance d’être façonné par la plus belle personne qui soit. Ma rencontre avec elle remonte au printemps 1984. Une jeune femme blonde, grande, belle, au sourire ravageur et au rire tonitruant est venue me trouver après une conférence de presse que je venais de tenir avec les juristes de la Cimade pour défendre les demandeurs d’asile italiens, espagnols ou irlandais. Elle m’a sidéré en me demandant si j’étais d’accord pour qu’elle me lise son papier au téléphone pour être sûre qu’aucune erreur ne s’y était glissée, car elle n’était pas juriste. C’était ma première leçon de journalisme : non, on ne sait pas tout comme par miracle et non, on n’est pas capable d’écrire sur tout. A partir de là, Béatrice a pris l’habitude de m’appeler – à l’époque des téléphones fixes et des machines à écrire.
De fil en aiguille, j’ai commencé à travailler avec elle au service Société sur les questions juridiques alors que je ne lisais pas Libé et que je n’avais aucune intention de devenir journaliste, mais avocat ou professeur de droit… Elle m’a littéralement aspiré à Libé en me montrant à quel point ce métier était joyeux, passionnant, aussi nécessaire à la démocratie que le droit. Sans que je m’en rende compte, elle m’a appris à écrire un article, à ne jamais hésiter à poser une question idiote («Ce qui compte c’est que tu comprennes ton sujet pour l’expliquer aux lecteurs et qu’eux se sentent intelligents»), à savoir raconter une histoire. Jamais je ne l’ai vu rejeter de la main une idée d’un air las : tout l’intéressait, l’amusait. «On ne peut faire un bon journal que si on prend plaisir à le faire», répétait-elle. Elle adorait discuter encore et encore jusqu’à nous faire accoucher d’un angle, d’un mode de traitement et au final d’un article dont nous étions tous fiers. Je n’étais pas le seul sujet de ses attentions, loin de là. «Ancienne», dans un journal alors si jeune, elle les prodiguait à tous avec une telle gentillesse que même les plus arrogants les ¬acceptaient.
Installé à demeure en 1986, je l’ai vue diriger le service Société, et j’ai compris ce qu’était un grand chef de service : Béatrice n’était jamais aussi fière que lorsqu’elle parvenait à faire briller ses journalistes, tant il est vrai qu’un journal n’est bon que lorsque toutes ses composantes sont excellentes. Elle n’était pas égotique, un exploit dans ce métier, son but était de faire le meilleur journal possible. Lorsque nos chemins se sont séparés, lors de mon départ à Bruxelles, en 1992, nous sommes restés très proches et j’ai toujours veillé à l’associer à mes choix professionnels. En dépit de notre infime différence d’âge, elle est restée ma mère en journalisme. Nous sommes nombreux à avoir quelque chose de Béatrice en nous, Libé au premier chef.